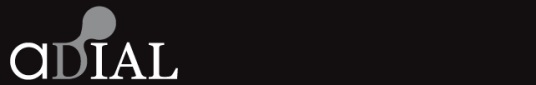A l’origine du concept de faute inexcusable de l’employeur se trouve un objectif : celui de la
santé et de la sécurité au travail. Si ces thèmes récurrents aujourd’hui constituent le noyau
dur autour duquel le droit du travail s’est construit, ils n’ont pas toujours été au coeur des
préoccupations.
Au XIXème siècle, les accidents du travail relèvent du droit commun de la responsabilité
délictuelle(1). Dans cette procédure longue et onéreuse, les victimes d’accidents du travail
étaient pour la plupart dans l’impossibilité d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice. En effet,
les tribunaux considéraient que les ouvriers avaient accepté, dans le prix du louage de leurs
services, les conséquences des accidents pouvant se produire au cours de l’exécution de
leur travail et qu’à ce titre, aucune indemnisation n’était dûe par l’employeur.
A cette époque, le développement industriel fut à l’origine de la multiplication et de
l’aggravation des accidents du travail provoqués notamment par la mécanisation du travail
ce qui poussa les tribunaux puis le législateur à intervenir pour édicter les premières règles
protectrices.
En 1841, la Cour de cassation vint récuser la position majoritaire des juges et rappeler la
prédominance de la faute en matière de responsabilité des employeurs. Mais les victimes
d’accidents du travail continuaient d’être privées de toute indemnisation, confrontées à la
difficulté voire l’impossibilité d’établir la preuve à la fois d’une faute de l’employeur, ou de son
préposé et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Face à cette contradiction entre le nombre croissant d’accidents du travail et l’absence
d’indemnisation, quelques tribunaux réagirent en se fondant sur l’obligation du patron de
prévoir et d’assurer la sécurité des ouvriers. L’un des arrêts les plus significatifs de ce
mouvement jurisprudentiel est l’arrêt Boissot du 7 janvier 1878. Par cet arrêt, la chambre des
requêtes confirma un arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 27 avril 1877 dont la motivation
était la suivante: « Le patron ou directeur d’industrie a la stricte obligation de protéger
l’ouvrier contre les dangers qui peuvent être la conséquence du travail auquel cet ouvrier est
employé ; cette obligation entraîne la nécessité, sous peine de faute, de prévoir les causes,
non seulement habituelles, mais simplement possibles d’accidents et de prendre les
mesures qui seraient de nature à les éviter ». La chambre des requêtes rejetait ainsi le
pourvoi formé par la Compagnie Schneider, dont un employé avait perdu un oeil par
projection d’un éclat de fonte enflammé, en relevant que l’accident aurait pu être évité si
l’employeur « obligé de préserver ses ouvriers des conséquences mêmes des dangers
inhérents à leur travail, avait pris les mesures nécessaires pour conjurer ces dangers ».
Dès lors, d’après le professeur Yves Saint-Jours, « L’obligation de sécurité à la charge de
l’employeur était ainsi conçue comme étant la contrepartie de l’autorité que celui-ci exerce
sur ses ouvriers, en vertu du contrat de travail, et envers lesquels il est tenu d’un devoir de
précaution et de prudence garantissant l’intégrité physique du salarié au travail. »
Cependant, les tribunaux se sont opposés à la reconnaissance de cette obligation
contractuelle de sécurité s’en tenant à la position suivante(2): «l’article 1710 du Code Civil qui
régit le contrat de louage et celui d’industrie n’impose pas aux patrons d’autre obligation que
de payer à l’ouvrier le prix convenu ».
Est alors apparue comme indispensable l’intervention du législateur en la matière. Celui-ci a
édicté les premières mesures défensives des travailleurs, d’abord au bénéfice des plus
fragiles : les femmes et les enfants, puis le champ de protection sera étendu à l’ensemble
des industries et à toutes les catégories de salariés. En 1892, l’Inspection du Travail est
créée et une loi pose les premiers jalons d’une politique globale de protection de la santé et
de la sécurité des travailleurs.
Mais la loi fondamentale pour la réparation des risques professionnels et pour la prévention
est celle du 9 avril 1898. Cette loi « concernant les responsabilités des accidents dont les
ouvriers sont victimes dans leur travail », dont le projet initial avait été déposé dix-huit ans
plus tôt, fut l’aboutissement de l’évolution jurisprudentielle qui inquiétait les employeurs
puisqu’elle tendait à instituer une responsabilité de quasi plein droit de ces derniers. On parle
d’un « compromis historique » réalisé par cette législation dans la mesure où elle a du opérer
un choix : faire supporter les risques auxquels sont exposés les travailleurs soit à l’ensemble
de la société soit aux employeurs eux-mêmes, censés supporter la charge des accidents
résultant de l’utilisation de leurs moyens de production.
Face à l’impossibilité de trancher, le législateur de l’époque a donc opté pour un système qui
abandonne la faute au profit du risque, facilitant ainsi la mise en jeu de la responsabilité de
l’employeur pour l’ouvrier mais qui en contrepartie offre une réparation forfaitaire afin de
ménager les intérêts patronaux. Ainsi est né ce système d’indemnisation systématique mais
forfaitaire toujours en vigueur à ce jour.
Cette conciliation réalisée par la loi entre partisans et adversaires de la substitution du risque
à la faute en matière de responsabilité, repose donc sur trois principes : la mise à la charge
de l’employeur du risque professionnel, la fixation d’une indemnité forfaitaire englobant tous
les accidents et la certitude de cette réparation pour l’ouvrier victime d’un accident du travail.
La loi de 1898 pose le principe d’une indemnisation des accidents du travail et des maladies
professionnelles dérogatoire de la responsabilité civile de droit commun permettant
désormais aux victimes d’accidents du travail d’obtenir une réparation forfaitaire de leur
préjudice sans avoir à supporter la preuve inhérente à la faute dans les régimes traditionnels
de responsabilité.
Ainsi, outre le remboursement des frais médicaux, la garantie principale réside dans
l’attribution d’une rente (ou d’une pension versée aux ayants droit en cas de décès) réparant
exclusivement, mais partiellement, la perte de salaire (dans la limite de 2 400 francs par an).
Dès lors, la contrepartie de l’abandon de la faute pour la victime est cette indemnisation
forfaitaire de la seule perte temporaire ou définitive de sa capacité de gain, exclusion faite
des autres troubles de l’existence : préjudice moral, professionnel ou familial. La rente
accident du travail avait donc pour seul objet, comme c’est toujours le cas de nos jours, de
réparer le préjudice subi par la victime dans sa vie professionnelle, c’est-à-dire sa perte de
salaire du fait de son incapacité.
Cette réparation forfaitaire était à la charge de l’employeur qui bénéficiait d’un éventuel
recours contre le tiers auteur de l’accident. Quant au salarié, toute action en responsabilité
contre son employeur fondée sur le droit commun lui est en contrepartie interdite, le droit de
la sécurité sociale se substituant au droit de la responsabilité civile.
Plus particulièrement, cette loi précise que le taux de la rente allouée en cas d’incapacité
définitive partielle ou totale, est susceptible d’être majorée ou minorée si une faute
inexcusable a pris part dans la survenance du risque.
Ici apparaît pour la première fois cette fameuse notion qui, un siècle plus tard, continue de
susciter de vifs débats.
Si cette notion est née dans ce texte, elle y est pourtant tout à fait marginale. En effet, elle ne
figure qu’à l’article 20 de la loi et peut-être celle de « l’ouvrier » qui aura pour effet de limiter
l’indemnité de ce dernier ou celle « du patron » ayant pour effet de majorer cette indemnité.
C’est l’affirmation du principe aujourd’hui intégré à l’article L452-1 du Code de la Sécurité
Sociale (CSS) : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux
qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une
indemnisation complémentaire…»
Cette notion dévoilée par le législateur n’est pourtant pas définie. Elle est considérée par les
auteurs de l’époque comme une faute située entre faute lourde et faute intentionnelle. Son
impact est minime en 1898, mais elle sera pourtant à l’origine d’une jurisprudence
considérable quant à sa définition et deviendra un enjeu majeur à partir de 1946.
En effet, le régime instauré en 1898 sera modifié, sans toucher aux principes fondamentaux,
par les lois du 13 juillet 1906 et du 1er juillet 1938 et sera étendu en 1919 aux maladies
professionnelles (MP). Enfin, la loi du 30 octobre 1946 l’a intégré à l’organisation générale de
la sécurité sociale, avec pour nouveauté, la prise en charge directe des indemnisations par
les caisses de sécurité sociale, disposant d’un recours subrogatoire contre le tiers
responsable. L’instauration de cette « avance » des caisses a permis de concrétiser le
principe de la certitude de la réparation désirée en 1898.
Ainsi, le régime actuel de la faute inexcusable est celui du Livre IV du Code de la Sécurité
Sociale. Les accidents du travail consécutifs à la faute inexcusable de l’employeur sont régis
par le régime spécifique défini par les articles L452-1 à L452-4 code de la sécurité sociale.
Ces articles prévoient :
– d’une part, une majoration de la rente Accident du Travail (AT) qui est allouée dans le
cadre de la procédure classique d’indemnisation des accidents du travail : dans la
limite de la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit du
montant de ce salaire dans le cas d’une incapacité totale
– et d’autre part, la réparation des préjudices subis du fait des souffrances physiques et
morales endurées à l’occasion de l’accident, des préjudices esthétiques et
d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou diminution de ses
possibilités de promotion professionnelle.
– Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité de 100%, il lui est alloué, en outre, une
indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date
de consolidation.
A titre d’exemple, pour un préposé de 40 ans ayant un taux d’Incapacité Professionnelle de
20% et un salaire annuel de 20 000€, les indemnisations s’élèvent en moyenne à 50 000 €,
tandis que pour le même salarié, si le taux d’IP est de 90% le coût total de l’indemnisation
due au titre de la « Faute Inexcusable » s’élève à plus de 200 000 €.
La faute d’une particulière gravité établie à la charge de l’employeur vient donc affecter la
nature de ce système de réparation des AT/MP, avant tout fondé sur le risque, et effacer le
caractère forfaitaire de l’indemnisation, la réparation étant censée devenir complète ou
quasiment.
En effet, la reconnaissance de la faute inexcusable a pour effet de réintroduire, au sein du
Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, une partie des mécanismes du droit commun de la
responsabilité civile. Là, où la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou
de l’accident entraîne la mise en oeuvre d’une réparation automatique et forfaitaire, la faute
inexcusable va conduire à une réparation plus proche du préjudice réellement subi.
En 2009, Les statistiques sur les accidents du travail(3) étaient les suivantes :
Sur 18 108 823 salariés, on décompte 651 453 accidents avec arrêt, 43 028 accidents avec
Incapacité Permanente (hors décès), 538 décès et 36 697 274 journées perdues par
Incapacité Temporaire.
Etroitement liée à l’assurance, la notion de faute inexcusable a fait, depuis son apparition,
l’objet de jurisprudences et doctrines pléthoriques. Pierre Sargos, ancien Président de la
chambre sociale de la Cour de cassation, président du conseil d’administration du Fonds
d’indemnisation des victimes de l’amiante, parle même d’une « saga triséculaire ».
Il convient donc par ce développement d’analyser quels sont les enjeux de ce régime
particulier de responsabilité de l’employeur qui suscitent aujourd’hui encore de vifs débats.
Ainsi, si la justice s’est d’abord intéressée à la définition de la faute inexcusable, (partie I)
elle s’attelle maintenant à l’indemnisation des victimes (partie II).
1 Même si à partir de 1896 pour pallier à ces difficultés, la Cour de cassation avait admis que soit
appliquée la notion de responsabilité du fait des choses, l’employeur répondant du dommage causé
par les objets dont il est propriétaire.
2 Rennes 20 mars 1893, DP 1893. 2. 256.
3 Hors maladies professionnelles, accidents du trajet, sinistres des catégories des bureaux, sièges
sociaux et autres catégories professionnelles particulières. Source : Caisse Nationale de l’Assurance
Maladie des Travailleurs Salariés – Direction des Risques Professionnels – Mission Statistiques – Août
2010